Nous allons aborder la complexité du thème de la place de la femme dans la société. Vaste programme, ce dossier ne fera qu’effleurer la densité de ces questions, dont de nombreux auteurs et autrices ont traité dans l’Histoire.
La place des femmes dépend du contexte historique et sociétal dans lequel nous l’abordons. Selon les époques et les sociétés, la place des femmes n’a cessé d’évoluer, comme celle des hommes, selon les contraintes qui pesaient sur l’existence des êtres humains. Ce dossier met l’accent sur la place de la femme dans la société occidentale, et plus particulièrement en France. Nous donnerons des repères historiques, aborderons la baisse du nombre d’enfants par femme, ainsi que les grands combats que nous pouvons relier aux femmes. Nous terminerons ce dossier en regardant comment il est possible de construire une place dans la société.
La femme dans la société occidentale (H2)
Dans nos sociétés dites occidentales, la place des femmes a longtemps été cantonnée à la sphère privée de la vie sociale.
Quelques repères historiques en France (H3)
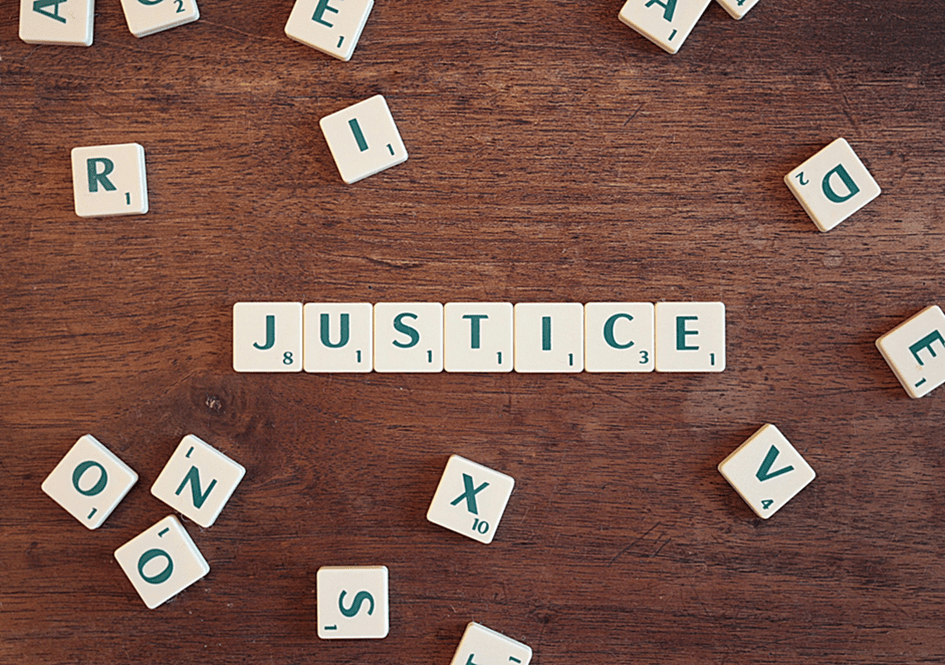
Droit de vote : pour rappel, les femmes ont obtenu le droit de vote en France en 1945, alors que la Révolution française datait de 1789. Ce changement leur a ouvert une place dans l’espace politique, celui où les lois s’écrivent, après débats à l’Assemblée nationale.
Compte bancaire : les femmes ne pouvaient ouvrir un compte bancaire qu’avec l’autorisation de leur mari, jusqu’au 13 juillet 1965 ; date à laquelle elles ont pu le faire, ainsi que travailler sans l’autorisation de leur mari. Il était temps, car les femmes travaillaient depuis longtemps, et ne pouvaient utiliser librement l’argent qu’elles avaient gagné, sans en référer à leur mari.
Contraception et grossesse : une des grandes révolutions sociétales du 20e siècle fut l’accès des femmes à la contraception chimique, autrement dit la pilule, puis la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en France, en 1974. Cette victoire politique, nous la devons à Madame Simone Veil, d’où le nom informel de cette loi, la “Loi Veil”. Je vous encourage à lire sa biographie, une leçon de vie et de courage politique. Vous comprendrez mieux le sens de la phrase “contre vents et marées”.
Tous ces changements ont été accompagnés par le mouvement de planification familiale et la création de centres de consultation dédiés.
Les femmes ont ainsi accédé à la maîtrise de leur fécondité, c’est-à-dire, à la possibilité de choisir le moment de leur maternité. Ces changements ont été facteur d’émancipation, libérant les femmes de la dépendance à leur mari. Elles ont pu alors choisir de s’engager dans de multiples professions, et de concilier vie familiale et vie professionnelle, non sans difficultés. En effet, le cumul de ces différents rôles et places, peut engendrer des tensions dans les couples. Les femmes ayant acquis plus d’indépendance, elles n’étaient plus condamnées à subir le poids de mariages où elles restaient assujetties au pouvoir de leur conjoint.
Toutes les avancées sociales, c’est-à-dire, l’accès à la contraception, l’évolution de la place de la femme dans la société, l’accès des femmes à l’emploi, en progression depuis le 19e siècle, leur accès au vote depuis 1945 en France, et la liberté d’ouvrir un compte bancaire sans avoir à solliciter l’autorisation du conjoint, ont permis aux femmes d’être plus libres de choisir leur mode de vie. Cette liberté s’applique aussi au choix de devenir mère, et de choisir également le moment d’avoir un enfant.

La baisse du nombre d’enfants par femme dans le monde (H2)
Le nombre d’enfants par femme diminue de façon continue dans le monde, à des rythmes différents selon les pays. Il est passé de 5 enfants par femme dans les années 1960 à 2,3 enfants par femme aujourd’hui.
À titre de comparaison, on compte 4,3 enfants par femme en Afrique, 1,64 enfants par femme en Amérique du Nord, 1,83 enfants par femme en Amérique du Sud, 1,51 enfant par femme en Europe et 1,93 enfants par femme en Asie.
La population mondiale est passée de 1 milliard d’habitants en 1800 à 8 milliards en 2023. Cette augmentation s’explique par la baisse de la mortalité infantile et maternelle, améliorations rendues possibles par les progrès de la médecine. Il en va de même pour l’allongement de la durée de vie, là encore différente selon les pays.
Les combats des femmes dans le monde (H2)
Les combats que les femmes ont menés et continuent à mener pour leur émancipation ont porté leurs fruits dans le monde. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, il reste de nombreux combats à mener. Tout n’est pas encore gagné.
De nombreuses femmes continuent à subir des discriminations dans le travail, où elles sont moins payées que les hommes dans certaines entreprises, à travail égal, et ce, quelle que soit la culture des pays où elles vivent. Certaines femmes sont également victimes de harcèlement dans les entreprises. Le mouvement social “MeToo” a eu le mérite de dénoncer ces réalités cachées sous les tapis, et ce, dans tous les milieux sociaux et professionnels.
Les violences conjugales (H3)
Les femmes ont toujours été assujetties au pouvoir des hommes, dans toutes les cultures du monde, et en tout temps, et pas seulement en temps de guerre.
Depuis une période récente de notre histoire, que nous pouvons situer dans les années 1960, la place des femmes dans la société s’améliore progressivement.
Malgré une meilleure lisibilité politique et sociale des violences exercées sur les femmes, elles perdurent et nous demandent de maintenir une vigilance permanente face à ce fléau.
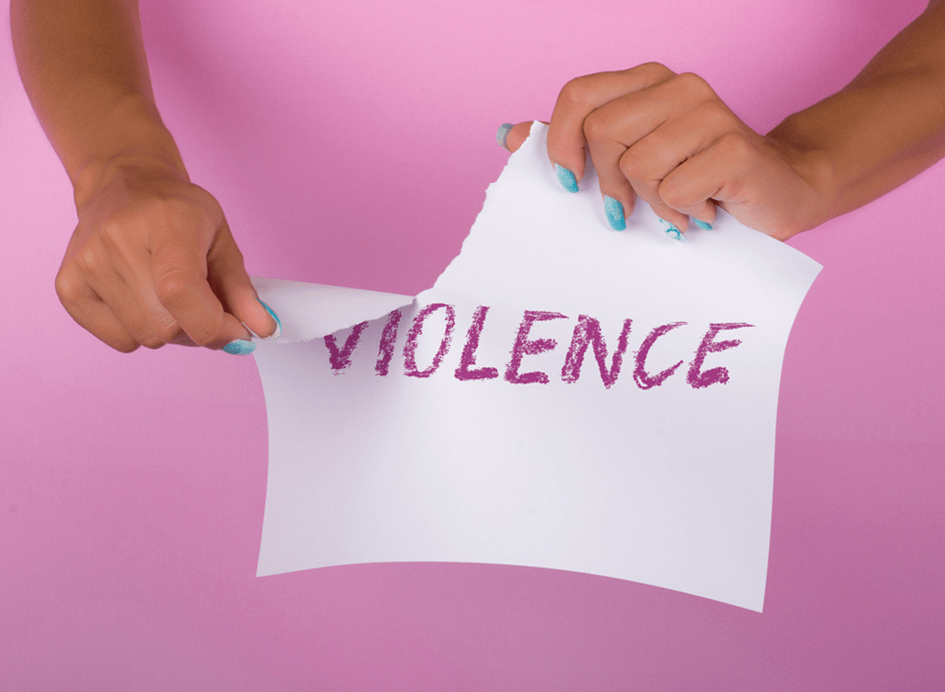
Je partage ici avec vous quelques informations plus personnelles. Depuis dix ans environ, nous pilotons, avec une collègue sage-femme, un groupe de projet dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, exposés aux violences conjugales, dans le cadre du réseau Périnat If Sud.
Le réseau regroupe des professionnel-les de périnatalité, médecins, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, psychologues, assistants sociaux, qui travaillent en maternité ou dans les services de protection maternelle et infantile, que ces professionnel-les travaillent en ville ou à l’hôpital.
Nous formons les professionnel-les à repérer les violences conjugales et à les accompagner vers une protection judiciaire, un hébergement adapté qui les protègent de l’agresseur et des soins.
Nous travaillons en lien avec les forces de l’ordre, les services de justice, les avocats et les associations qui soutiennent les femmes et leurs enfants dans le parcours de protection.
Pour rappel, 40 % des violences conjugales commencent pendant la grossesse, d’où l’importance de notre engagement au réseau Périnat If Sud.
Nous formons également les professionel-les à repérer et traiter les graves conséquences des violences conjugales sur le développement des enfants, y compris la santé du foetus quand une femme enceinte est victime de violences conjugales.
L’image de la femme idéale ou “wonderwoman” (H2)
Revenons maintenant sur la représentation de la “femme idéale” ou l’image de la “wonderwoman”. Cette représentation est développée et entretenue dans les médias, la figure de Wonderwoman étant le pendant féminin de Superman, ce super-héros capable de vaincre tous les périls. Mais d’où viendrait cette injonction de perfection ? Comme si les femmes devaient encore prouver toujours plus, de leurs capacités à faire face aux nombreuses responsabilités qui sont les leurs.
Laissons de côté cette injonction qui continue d’entretenir des inégalités entre hommes et femmes, et regardons comment se forge avec le temps la place que nous prenons dans la société.
La construction d’une place sociale (H2)
Nous avons d’abord appris la répartition des places dans notre famille, par transmission intergénérationnelle, consciente et inconsciente. Quelle était la place de nos parents, en tant qu’adultes et enfants par rapport à nos grands-parents ?
Puis en grandissant, nous avons appris la diversité des représentations à l’extérieur de notre famille, à l’école, dans les différents lieux de vie sociale que nous avons fréquentés. Nos instituteurs, professeurs et formateurs divers nous ont apporté des figures d’identification positives ou négatives.
Enfin, nous avons également appris de nos lectures, des films vus au cinéma, forgeant ainsi ce qui a fait de nous des adultes. Sans oublier, la place prise par les réseaux sociaux dans l’évolution de ces questions. Pour le meilleur et pour le pire…
Ces représentations sociales des places des femmes et des hommes, et leurs interactions, sont en perpétuel mouvement.
Pour chacun de nous, découvrir notre personnalité, nos talents et nos limites, est conditionné par la qualité de nos parents, de l’éducation et des valeurs qu’ils nous ont transmis, pas seulement par des déclarations d’intention, mais surtout par leur savoir être et leur engagement éthique.
Trop longtemps les femmes étaient considérées comme une menace par les hommes qui se sentaient obligés d’exercer un contrôle permanent de leur vie, par la violence si nécessaire.
L’apprentissage des différences et de l’égalité entre hommes et femmes commence dès l’enfance. Cet apprentissage doit être incarné. L’enfant doit pouvoir constater que les propos tenus sont en adéquation avec les actes, quand il vit et observe les relations entre hommes et femmes dans sa famille et son environnement social.
De nombreuses actions de prévention dans les crèches et les écoles maternelles sont menées dans ce sens.
La place des femmes dans la société. Et les hommes ? (H2)
Dans un souci de complémentarité, nous pouvons ici aussi nous demander ce qu’il en est pour les hommes. Dans tout cela, où en sont-ils ? Quelle place pensent-ils occuper aujourd’hui ? Je vous laisse le soin de répondre à cette question, pour enrichir le contenu de nos actualités et plus loin, votre réflexion sur ces questions fondamentales, qui nous portent, comme sujets de nos multiples vies : conjugales, familiales, professionnelles, et sociales.
Ces questions définissent nos appartenances, nos engagements et notre champ de responsabilités dans l’espace privé et public, social et politique, au sens de notre rôle dans la cité humaine, où nous vivons, et transmettons aux générations qui nous succéderont, les valeurs qui peuvent contribuer à rendre leur vie meilleure. Mais qu’est-ce qu’une vie meilleure ? Question représentant un autre vaste sujet. Je vous recommande de lire à cet égard, l’ouvrage lumineux de l’écrivaine américaine Toni Morrison, “La source de l’amour-propre”.

